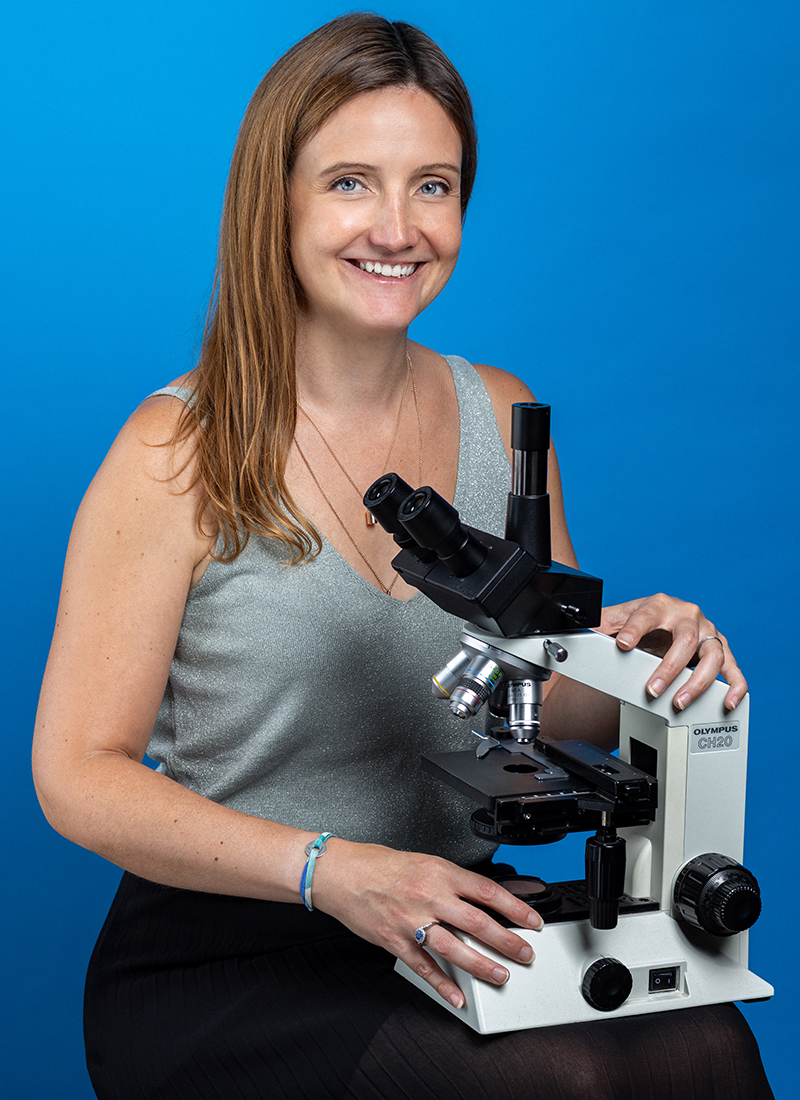
Chercheuse passionnée par les abysses et les micro-organismes marins, Pauline Vannier, Maître de conférences à l’UFR Sciences et Techniques, s’intéresse à ce que l’on ne voit pas, mais qui structure pourtant toute la vie des océans : les bactéries. Elle étudie leur rôle dans la dégradation des plastiques au fond des mers, un enjeu écologique majeur encore largement méconnu. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, ses recherches et sa conviction profonde : « protéger l’océan, c’est protéger notre avenir commun. »
Souvent je me présente comme biologiste marin mais en réalité, je fais de la microbiologie. Je m’intéresse aux micro-organismes qui composent l’océan de manière invisible. Ce sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Si on les perturbe, c’est tout l’écosystème qui est bouleversé. Ça a une importance cruciale et pourtant les gens ne s’en préoccupent pas.
Thomas Pesquet lors de la conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC) a rappelé qu’on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. C’est fou, non ?
Il y a tout à découvrir sur le fond des océans, notamment sur la microbiologie des abysses. C’est pour ça que le microscope est symbolique pour moi.
Je ne comprends pas qu’on ne prenne pas plus soin de notre environnement. Pendant des décennies, on a tout jeté au fond de la mer en pensant que ça ne poserait pas de problème.
Il y a des déchets nucléaires immergés à 4 000 mètres au large des côtes bretonnes. C’est la même logique avec les satellites. Quand ils deviennent inutilisables, on les fait tomber pour qu’ils brûlent dans l’atmosphère mais une partie résiste et finit dans un « cimetière » au fond du Pacifique. On ne sait pas ce que cela devient mais ce n’est pas grave, c’est invisible. Ce « pas vu, pas pris » m’agace profondément.
« Le “pas vu, pas pris” m’agace profondément ! »
La Méditerranée est l’une des mers les plus polluées, voire la plus polluée au monde en termes de plastiques. On parle souvent des plastiques flottants en surface mais c’est minime par rapport à ce que l’on retrouve dans les profondeurs.
Là, dans les abysses, il n’y a pas de lumière, très peu de nutriments qui descendent de la surface, et une pression écrasante. Et pourtant, la vie prolifère. C’est magique ! Mais on y accumule des déchets qui n’ont rien à voir avec cet écosystème. Ce que je veux comprendre, c’est ce qui se développe à la surface des plastiques. Quand on laisse un objet longtemps dans l’eau, il devient gluant. Ce côté « gluant », ce sont des bactéries qui colonisent la surface. Dès qu’on immerge un objet, des bactéries s’y développent. Et certaines bactéries sont capables de dégrader le plastique, de le « manger » vraiment, de le digérer. C’est ça que j’étudie.
C’est compliqué parce qu’il faut descendre parfois à plus de 4 000 mètres. On travaille donc avec l’Ifremer, l’institut français de recherche entièrement dévolu à la connaissance de l’océan, et leurs moyens techniques.
Je pense que notre travail en tant que chercheurs, c’est de transmettre pour pouvoir mieux protéger. L’océan est un puits de carbone : il absorbe une grande partie du CO₂ et des gaz à effet de serre que nous produisons. C’est bien, ça profite à tout le monde. Mais si on y accumule des plastiques, qui sont eux-mêmes du carbone. Est-ce qu’on ne perturbe pas ce mécanisme ? Est-ce qu’on accentue l’impact du réchauffement climatique ? Et jusqu’à quand l’océan sera-t-il capable d’absorber ?
C’est crucial, parce que les conséquences du changement climatique, on les vit déjà : sécheresses, pluies diluviennes, inondations, canicules. On a tendance à croire que ce sont des phénomènes lointains, mais non, c’est ici et maintenant.
Et puis il y a la question de notre alimentation. Les microplastiques sont ingérés par les petits poissons, qui sont mangés par les plus gros… Au final, quand on mange du thon par exemple, on mange aussi toutes les toxines et plastiques accumulés. Ce n’est pas anodin. Il faut comprendre que cela va avoir des conséquences sur notre santé. Ce serait bien que l’on puisse manger des aliments sains, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Depuis l’âge de six ans, je dis que je veux être chercheuse en biologie marine. Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’était clair. J’ai suivi ce chemin, et à l’université, je suis allée à une conférence grand public donnée par un chercheur, Daniel Prieur, qui faisait un parallèle fascinant entre les sources hydrothermales des abysses - des sources chaudes où la vie prolifère - et la possibilité de vie sur d’autres planètes. Là, j’ai découvert l’exobiologie, la biologie « extraterrestre ».
J’ai appris que, dans les sources hydrothermales, la vie ne dépend pas de la photosynthèse comme à la surface, mais de la chimiosynthèse, c’est-à-dire de réactions chimiques produites par des micro-organismes. Ça a été un déclic. Le lendemain, j’étais dans son bureau à demander un stage en microbiologie, une matière que je ne connaissais pas du tout. Et c’était fini, j’étais happée.
J’étais très sérieuse, parce que j’étais très timide. Être bonne élève, c’était une sécurité : je me camouflais, ne me faisais pas remarquer, on ne se moquait pas de moi, on ne m’embêtait pas. Toute ma scolarité, on m’a répété que je n’y arriverais pas en sciences. En biologie, ça allait mais, malgré mon travail acharné, mes notes en dessous de la moyenne en maths et en physique montraient que je n’avais pas le profil. On me poussait vers les lettres. Et j’ai refusé.
Je voulais être biologiste marine, point. Je suis têtue. Avec le contexte océanographique, tout a pris du sens : la physique appliquée à la mer, les statistiques appliquées aux écosystèmes… Là, ça me parlait. Et puis lorsque j’ai compris aussi que l’on pouvait gagner à des jeux de cartes avec des probabilités et des statistiques, j’ai trouvé ça fun. Alors oui, ça a été difficile, il a fallu rattraper les lacunes mais ça se fait.
« C’est un parcours du combattant, oui, mais ça vaut le coup »
Non, loin de là. J’ai grandi à Reims, fait ma licence là-bas, mais j’ai doublé ma troisième année pour pouvoir intégrer l’Université de Bretagne Occidentale et faire le master de biologie marine à Brest. Pendant ce temps, je travaillais en restauration pour financer mes études. Ça prend du temps et de l’énergie mais ça m’a permis de financer mon départ, mon ordinateur et mon permis de conduire.
Le master, je me suis éclatée. On est enfin spécialisé, on fait ce qu’on aime. Il en est de même pour la thèse : je l’ai vécue comme un plaisir, même si c’est beaucoup de travail. Mais j’étais passionnée, et on avait une super équipe de six doctorants, on travaillait ensemble tout le temps, on s’épaulait.
Persévérer. Croire en ses rêves, même si ça sonne un peu naïf. Parce qu’on va passer 40 ans, ou 50 ans dans ce métier – on ne sait pas trop quand on sera à la retraite alors autant que ça nous plaise. Ce n’est pas grave si on se trompe, si on se rend compte en licence que ce n’est pas pour nous. Mais il faut essayer, il faut oser. C’est un parcours du combattant, oui, mais ça vaut le coup.
Et ne pas écouter ceux qui disent qu’ils n’ont pas le niveau, il faut trouver la motivation pour leur prouver le contraire. En France, les notes sont très importantes, on ne prend pas assez en considération la motivation même si c’est en train de changer.
Oui. J’aime beaucoup une image dans laquelle un scaphandrier tend son doigt vers le haut, et un cosmonaute tend le sien vers le bas, pour se rejoindre comme dans la fresque de la chapelle Sixtine. Ce parallèle entre ce qui se passe dans l’espace et ce qui se passe dans les abysses, je le trouve magnifique : si on comprend nos océans, on comprendra mieux d’autres planètes.
Et puis bien sûr, j’ai été biberonnée par Le Grand Bleu. Je ne compte plus le nombre de fois où je l’ai vu, avec une préférence pour Jacques Mayol et son côté rêveur.
Je pense qu’on a beaucoup à gagner à rapprocher la science et l’art. À Marseille, j’ai vu une exposition superbe sur la bioluminescence qu’on retrouve dans les grands fonds, c’était très visuel, poétique. La science doit aussi passer par l’émotion pour sensibiliser.