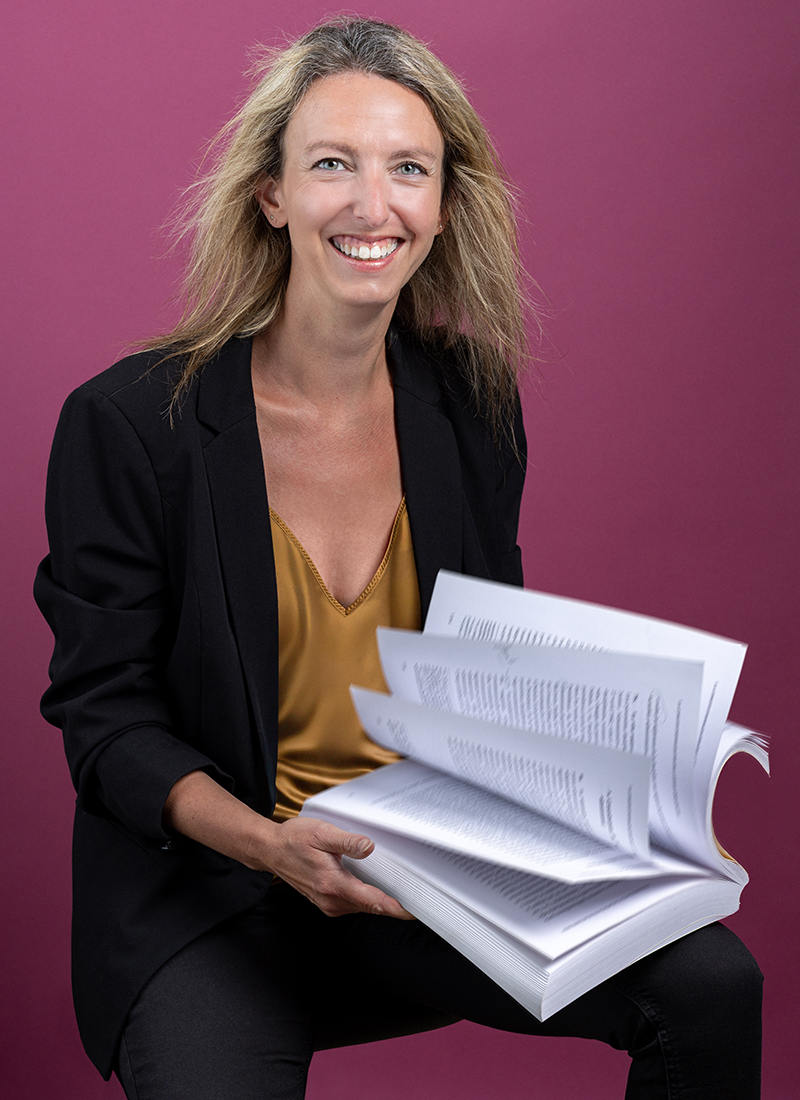Céline MAILLAFET, laboratoire CDPC
Au Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras (CDPC-JCE), Céline Maillafet occupe un poste clé, souvent invisible mais pourtant essentiel : celui d’ingénieure d’études (IGE) - coordinatrice des activités de recherche. Docteur en droit public, elle conjugue rigueur scientifique, sens de l’organisation et passion pour la transmission du savoir. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, son métier, sa vision du droit… et l’importance d’aimer ce que l’on fait, à l’ombre comme à la lumière.
Tu poses sur la photo avec un objet très particulier : ta thèse. Pourquoi ce choix ?
C’est le symbole de l’aboutissement de 7 années de dur labeur, d’un travail passionnant et passionné, que j’ai mené sous la direction du Professeur Jean-Jacques Pardini, à la Faculté de droit de l’Université de Toulon et au CDPC-JCE qui est mon laboratoire actuel d’affectation. Ma thèse porte sur deux disciplines juridiques qui se croisent : les contentieux constitutionnel et administratif et j’ai comparé les expériences française et italienne.
La thèse marque vraiment le début de la carrière professionnelle. Elle est un rite de passage, une épreuve intellectuelle intense.
Justement, ton poste d’ingénieur d’études, c’est quoi au juste ?
C’est un poste d’appui à la recherche, c’est-à-dire en coulisses mais qui permet que bon nombre de choses fonctionnent.
Concrètement, j’accompagne les chercheurs, entre autres, dans le montage des projets sur les points financiers et logistiques (pour répondre à des appels à projets), dans l’organisation logistique des manifestations, avec la valorisation des publications…
Je réalise aussi, sous la responsabilité de la direction du CDPC-JCE, le recensement des activités des membres du laboratoire : publications, expertises, participations à des colloques… Ce bilan est ensuite utilisé pour les évaluations de l’université, de l’UMR ou de l’HCERES.
« Avec la recherche, on explore, on découvre, on se découvre »
Tu as participé à l’organisation d’un événement scientifique d’envergure récemment…
Oui, le congrès français de droit constitutionnel, une manifestation majeure organisée tous les trois ans en partenariat avec l’Association française de droit constitutionnel. Ce congrès était porté par le Doyen Thierry Di Manno. On a accueilli plus de 400 participants, français et étrangers, avec 7 ateliers, une soirée de gala… C’était une organisation bien plus complexe que nos colloques habituels, qui réunissent 20 ou 30 personnes. Là, c’était un vrai défi logistique, de coordination, de représentation du CDPC-JCE et de l’Université aussi.
Je ne suis pas spécialisée en événementiel, mais j’apprends vite ! Il a fallu collaborer avec tous les services de l’Université et de nombreux partenaires extérieurs, mettre en place des procédures inédites. C’était un sacré challenge pour le responsable scientifique du projet et toute l’équipe qui a participé à l’organisation (doctorants, personnels des services financiers, communication et informatique), mais on en est ressortis très fiers.
Comment définirais-tu ton rôle dans l’écosystème de la recherche ?
Tous les laboratoires n’ont pas l’opportunité d’avoir un IGE ; dans ce cas, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui doivent gérer l’administratif, ce qui leur prend un temps précieux, qu’ils ne peuvent pas consacrer à la recherche. Le CDPC-JCE est un centre à fort effectif (chercheurs et doctorants), raison pour laquelle un IGE est affecté.
Je suis depuis 6 ans sur le poste : je commence à être rodée, je connais certains rouages (où aller, à qui m’adresser sur un point logistique) ou les points à mettre en avant pour répondre à un appel à projet (pluridisciplinarité, ouverture internationale).
Tu fais aussi de la recherche et tu enseignes…
Oui, à côté de mon poste, je fais toujours de la recherche. Je publie (articles, commentaires…) ; j’organise des colloques et des conférences dans des domaines variés (le droit pénitentiaire en binôme avec ma collègue Catherine Tzutzuiano, MCF en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Toulon ; le droit de l’environnement…)
Je suis docteure en droit, j’ai été formée dans le monde de l’enseignement et de la recherche. Et j’ai cette curiosité naturelle que la recherche nourrit : on enrichit constamment ses connaissances. On va au fond des choses, on explore, on renouvelle son champ de connaissances, on découvre, on se découvre… J’enseigne aussi toujours…
J’aime cette dualité : être à la fois dans l’opérationnel, le concret, et dans la réflexion plus théorique.
Justement, tu dis souvent que tu es « polyvalente », un peu Shiva à mille bras…
J’aime bien cette image. Il faut penser à tout, tout le temps. C’est ce que j’aime dans ce métier aussi. Il y a une grande variété de tâches, on ne s’ennuie jamais. Mais il faut être organisé, rigoureux, savoir s’adapter en permanence. Il faut aussi comprendre les attentes spécifiques des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui ne sont pas les mêmes que dans les sciences « dures ».
Est-ce qu’il faut forcément avoir fait de la recherche pour occuper un poste comme le tien ?
Pas forcément, mais ça aide énormément. J’ai fait ma thèse au sein du CDPC-JCE et j’avais aidé lors des colloques, donc je connaissais l’écosystème, les codes… Ça facilite grandement la prise de poste. Quelqu’un qui viendrait d’un autre univers devrait probablement passer par une phase d’acclimatation un peu plus longue, mais rien n’est impossible.
Qu’est-ce que tu retires de ton travail aujourd’hui ?
J’ai beaucoup appris, notamment du point de vue de l’organisation d’un projet, mais aussi en matière budgétaire. Cela m’a permis d’appréhender la gestion d’un laboratoire. Il y a des tâches chronophages, moins stimulantes, mais quand il y a un nouveau projet, ça me redonne de l’élan. Et surtout, je suis fière d’être un appui. Fière de contribuer à la valorisation des recherches, à la visibilité du laboratoire. Quand on me dit que tel événement a été parfaitement organisé, c’est une grande satisfaction, même si je n’étais pas sur le devant de la scène.
J’aime bien être à l’ombre, finalement. Faire en sorte que tout se passe bien mais ne pas être mise en avant.
« Ne pas avoir peur de l’échec : soit on gagne, soit on apprend »
Comment en es-tu venue au droit, justement ? Est-ce que c’était une vocation ?
Pas du tout ! J’ai fait un bac littéraire pour étudier les langues (anglais, espagnol, italien). Je voulais faire un double cursus langues étrangères appliquées et droit parce que mon objectif professionnel était de rentrer au ministère des Affaires étrangères. Deux événements marquants m’ont fait m’orienter vers le droit : j’ai détesté les cours de philo mais j’ai été passionnée par deux textes - Le Prince de Machiavel et De L’esprit des lois de Montesquieu, tous deux sur l’organisation des pouvoirs, de la société, comment la liberté est garantie -. Être libre est très important pour moi, cela caractérise bon nombre de mes actions.
À l’époque, ce n’était pas courant de faire un double cursus, j’ai donc choisi le droit. Très vite, les matières de droit public m’ont plu : droit constitutionnel, droit administratif… Et puis un jour, j’ai découvert le droit comparé. Ça a été une révélation. J’ai retrouvé mes langues vivantes dans le droit. J’ai fait un mémoire, puis ma thèse en droit comparé. Et je continue aujourd’hui à travailler en droit comparé. C’est un peu comme l’ADN de ma conception de la recherche…
Quel genre d’élève étais-tu, au collège ou au lycée ?
Au collège, plutôt bonne élève, sans trop forcer. À l’époque ce qui me frustrait c’est qu’on ne pouvait être bonne élève et drôle à la fois. Au lycée, j’ai fait une crise d’ado, j’ai changé de look, de personnalité et j’ai retrouvé un peu plus de liberté. C’est à l’université que je me suis vraiment révélée, l’environnement est plus libre, plus propice à l’épanouissement. Aujourd’hui, je suis plutôt extravertie mais à l’époque, je n’aimais pas me mettre en avant, j’étais timide.
Et si tu devais parler à un élève qui hésite à faire du droit, tu lui dirais quoi ?
De ne pas se fermer de portes. De faire ce qui lui plaît. Et surtout, de ne pas avoir peur de l’échec : soit on gagne, soit on apprend. C’est très philosophique, mais je crois vraiment à ça. Le droit, même si on n’en fait pas toute sa vie, donne une culture générale incroyable. On comprend comment fonctionne notre société. C’est une vraie richesse.
Une dernière question : si tu devais associer ton travail ou ta recherche à une œuvre – livre, chanson, film, tableau… – ce serait laquelle ?
Ouh là, tu me poses une colle ! Franchement, je ne sais pas. Je suis influencée par plein de choses, mais je ne vois pas d’œuvre qui résumerait parfaitement ce que je vis…