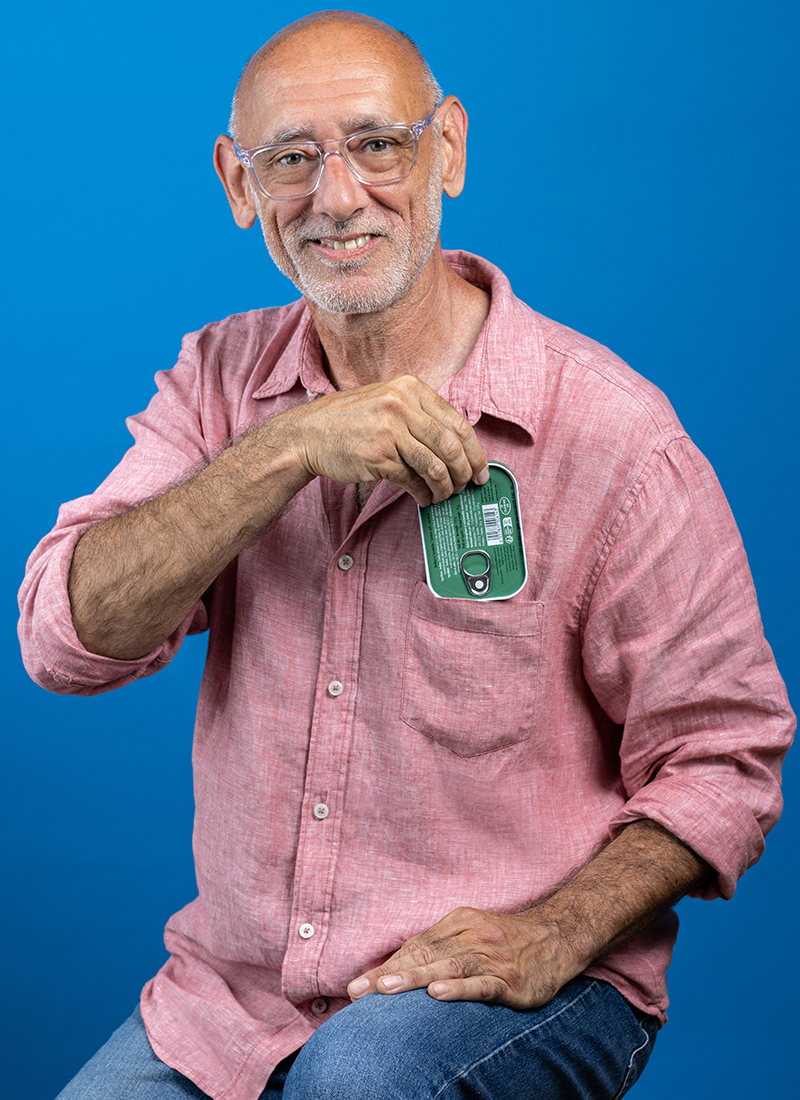Pascal RICHARD, laboratoire CERC
Professeur des universités de droit public à l’Université de Toulon et codirecteur du Lab’Homere (laboratoire d’innovation publique), Pascal Richard consacre actuellement ses recherches à l’effectivité des politiques publiques, en particulier dans le domaine littoral et maritime. Pour lui, le droit n’est pas une abstraction : c’est un objet vivant, qui s’écrit, se lit, se prend en main, et qui façonne nos vies. Rencontre avec un juriste passionné de textes, d’ergonomie normative… et de Borges.
L’objet que tu as choisi pour la photo, une boîte de sardines, peut surprendre. Pourquoi ce choix ?
Au-delà de l’aspect anecdotique et de la plaisanterie liée à l’objet un peu atypique, cette boîte de sardines est symbolique au moins pour trois aspects.
D’abord, elle renvoie directement à mes recherches dédiées à la Méditerranée et à l’effectivité des politiques publiques. La gestion des ressources halieutiques, la protection de la biodiversité sont très importantes pour ma collègue Sophie Pérez et moi-même. Une boîte de sardines, c’est une manière concrète et parlante d’évoquer tout ça.
L’autre élément qui m’intéresse, c’est la boîte en elle-même. Comment elle est devenue reconnaissable, peu à peu, pour toutes personnes qui la regardent. Ç’est l’aspect que nous travaillons depuis 3-4 ans, qui tient à la prise en main des politiques publiques. Pour moi, c’est une belle métaphore : de la même manière que l’objet manufacturé doit être pensé pour être pris en main, la norme juridique doit être conçue pour être intelligible et applicable.
Enfin, une anecdote que j’aime beaucoup. Le psychanalyste Lacan racontait qu’un jour, alors qu’il était plein de lui-même comme toutes les personnes qui viennent de terminer brillamment leurs études, il est parti faire une campagne de pêche avec des marins bretons. Un moment, un des marins lui dit : « tu vois cette boîte de sardine qui flotte sur la mer ? » Lacan ne voit qu’un éclat de lumière, quelque chose qui brille. « Eh bien, elle, elle te regarde. » Pour lui, c’était une leçon d’humilité. Pour moi, juriste, c’est une belle image du droit. Être capable de voir au-delà du texte, de percevoir ce qu’il véhicule vraiment, c’est un vrai défi pour nous.
Justement, comment résumerais-tu tes recherches ?
J’ai choisi de travailler sur les politiques publiques. C’est-à-dire une manière pour le droit de s’incarner dans l’action. Pourquoi, à un moment donné, une règle est-elle respectée ? Pourquoi nous conformons-nous à une norme ? C’est presque magique.
Nous avons trouvé un terrain de jeu avec ma collègue, qui est celui des politiques publiques littorales et maritimes. Un terrain encore peu exploré. Nous sommes le premier laboratoire d’innovation publique en France à travailler de ces questions-là sur la totalité de la façade méditerranéenne.
L’idée est simple : une bonne règle juridique, c’est une règle que tu appliques sans même te poser la question. C’est de l’ergonomie normative. Comme une boîte de sardines, la norme doit être lisible, claire, accessible. Notre objectif, c’est d’aider les institutions à produire des textes qui suscitent l’adhésion, pas la contrainte.
« Le droit, c’est de la magie et de la littérature »
Pourtant, on a l’impression aujourd’hui que beaucoup de règles ne sont plus respectées. Pourquoi ?
C’est vrai. On observe un désaveu de la parole publique. Quand la norme peine à être appliquée, il y a deux solutions classiques : soit on sanctionne, soit on fait semblant de donner la parole aux citoyens. Ça marche un peu, ça fait plaisir, mais ça n’a pas véritablement un impact dans les politiques publiques.
On sait qu’il y a trop de normes, qu’elles sont parfois illisibles. Souvent on dit que « la norme, c’est le texte et sa signification » mais ce n’est pas vrai. La norme, c’est la manière dont le destinataire appréhende le texte, la façon dont il se sent dans le devoir de l’accomplir lorsqu’il l’a entre les mains. L’idée que nous développons, ce n’est pas de produire plus de textes, mais de réfléchir à la façon dont ils sont écrits, présentés, compris. C’est ça l’ergonomie normative.
Comment es-tu venu au droit ? Était-ce une vocation de jeunesse ?
Pas vraiment (rires). Moi je voulais être libraire, j’aime les livres. À l’époque, l’offre de formation n’était pas celle qu’elle est aujourd’hui et je n’avais pas les moyens d’aller ailleurs. Ma copine voulait faire du droit, je l’ai suivie et je n’en ai jamais eu le remords. La vie fait bien les choses. Le droit me permettait de lire, d’écrire… Je suis un juriste qui considère que le droit c’est de la littérature. Drôle de juriste ! Je suis arrivé là un peu par hasard et par amour des textes.
Qu’est-ce qui t’a séduit dans cette discipline ?
Le droit, c’est de la magie. Demande à quelqu’un pourquoi il obéit : il ne sait pas vraiment répondre. Ce n’est pas seulement par peur d’être puni. En réalité, on obéit parce que c’est notre « forme de vie ».
Le droit est au cœur de l’anthropologie, de la philosophie, de la littérature. C’est une discipline « ancillaire » comme disent certains, parce qu’elle est au service de la société. Mais en même temps, elle la structure, elle l’informe. Et ça, c’est fascinant.
Et puis, le droit est une discipline pleine d’humour. La seule définition valable, c’est : « le droit, c’est ce que le droit considère comme étant du droit ». C’est à la fois absurde et merveilleux.
Et ton parcours scolaire, comment s’est-il construit ?
J’ai grandi dans le Var, dans un quartier populaire où les perspectives étaient limitées. J’ai eu la chance de faire des rencontres déterminantes.
D’abord, la boxe anglaise. Mon frère la pratiquait et je suis un passionné, mais un passionné, un passionné, un passionné, un passionné… J’ai commencé très jeune, et je n’ai jamais vraiment arrêté. Ça a été une école de vie merveilleuse : prendre des coups, se relever et se dire que ce n’est juste « pas grave », la capacité à se dire que lorsque tu es enfermé dans un petit carré, il faut lui donner du sens.
Ensuite, à l’université, j’ai eu la chance d’être très bien entouré. Ma directrice de thèse était exigeante mais profondément humaine. Grâce à elle, je n’ai jamais eu l’impression que c’était difficile. Je pensais même que faire une thèse allait être facile ! Quand tu es en confiance, tu peux aller au bout du monde.
« En réalité, de temps en temps, il faut être juste un peu curieux »
Quel étudiant étais-tu ?
Au lycée, j’étais plutôt assidu et sérieux. Mes profs ne diraient peut-être pas forcément ça mais ils ne me notaient pas mal, donc je ne dois pas être si loin que ça de la vérité.
Au collège, c’était plus compliqué. Comme beaucoup d’ados dans un environnement difficile, j’aurais pu basculer. Je dois énormément aux entraîneurs qui m’ont accompagné. La boxe m’a sauvé.
À l’université, j’ai toujours aimé ce que je faisais. Et quand tu aimes, tu n’as pas l’impression de travailler.
Si tu devais donner un conseil à un collégien ou un lycéen d’aujourd’hui ?
Je lui dirais : sois curieux. On s’arrête généralement trop tôt. Quand on va au cinéma, on va voir des films qu’on aime voir. On lit des livres qu’on sait déjà qu’on va les aimer. En réalité, de temps en temps, il faut être juste un peu curieux.
Il a des matières que tu peux détester mais quand tu les travailles, tu te rends compte que c’est plus intéressant que cela en avait l’air. Et au bout d’un moment, tu peux te réapproprier la matière, trouver ton espace de liberté. C’est une capacité que nous avons tous. Détester quelque chose suffisamment longtemps, c’est un engagement. Il ne faudrait pas que ce soit perdu.
Pour terminer : une œuvre qui symboliserait ta recherche ?
Deux auteurs m’accompagnent depuis toujours : Borges et Perec.
Borges, comme une évidence, qui m’a fait aimer les livres en me disant qu’il y avait quelque chose au-delà de l’objet. Chez Borges, il y a des labyrinthes, des miroirs et de temps en temps, il y a des tigres. J’ai trouvé ça fascinant. Trouver que dans la vie il y a des labyrinthes et toujours la possibilité d’en sortir, des miroirs qui permettent de te regarder et finalement d’en apprendre plus sur toi-même. Et si de temps en temps, tu peux croiser un tigre…
Et Perec, pour La Vie mode d’emploi. Un bouquin fait d’extraits qui constituent une carte invisible. Tu te balades dans un immeuble sans passer deux fois par les mêmes endroits. Tu as un puzzle, qui est l’objet du bouquin, que le personnage principal peint en blanc pour le recomposer par la suite, avec des jeux de mots tout le temps, des renvois en miroir que tu ne vois pas. Et dès le départ, une injonction : « Regarde, regarde de tous tes yeux. »
C’est un peu ça la recherche : regarder, explorer, assembler des morceaux, découvrir des liens cachés. Même les codes juridiques, si tu sais les lire, peuvent devenir fascinants.